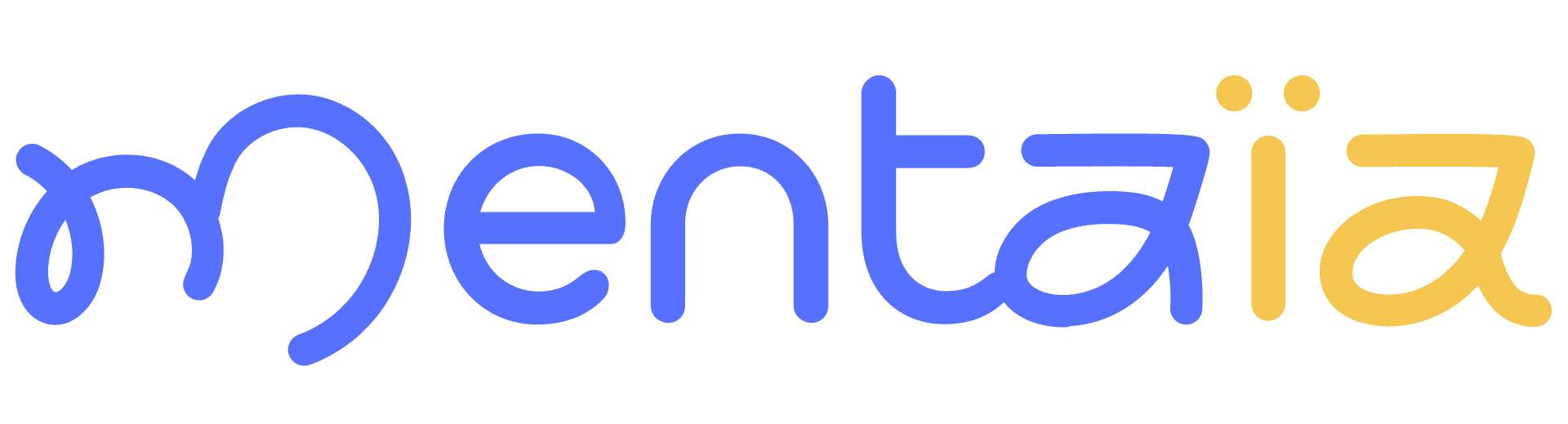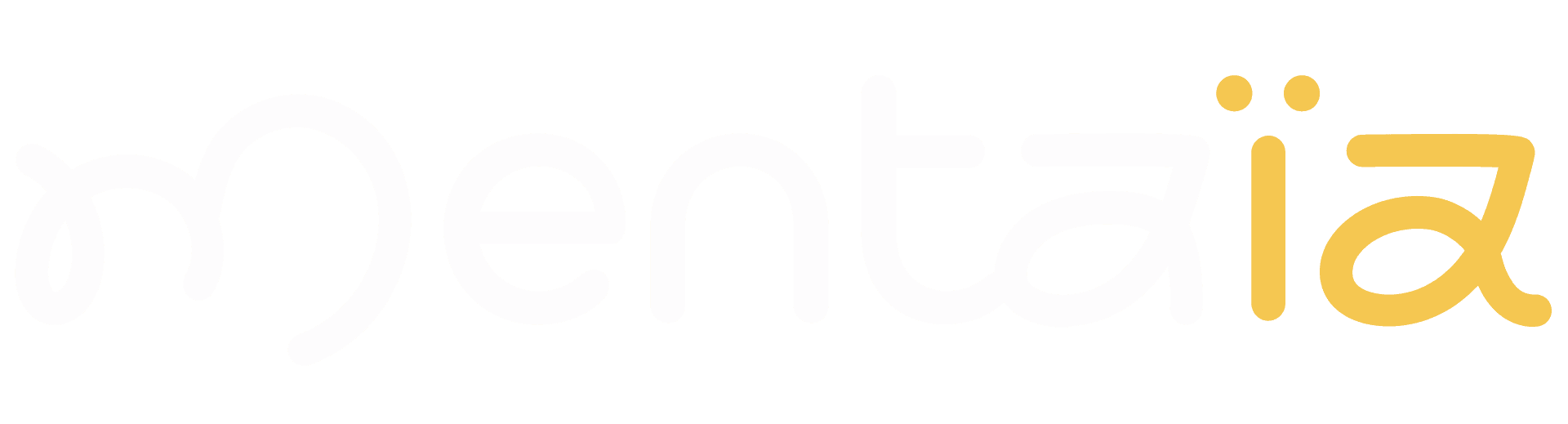Quand neurosciences et psychologie du sport redéfinissent notre rapport à l’attention
Dans un monde saturé de sollicitations, la concentration est devenue une denrée rare. Pourtant, dans les milieux à haute exigence (sport de haut niveau, entreprise, médecine, arts) elle est une condition de la performance durable. Et contrairement aux idées reçues, la concentration n’est pas innée: elle s’apprend, se cultive, s’adapte.
Les travaux en neurosciences (Lachaux, 2011 ; 2015) et en psychologie du sport (Bernier, 2024) nous montrent une chose essentielle: l’attention est une ressource limitée, soumise à des lois précises… mais malléable avec méthode.
I. L’attention: une dynamique directionnelle et contextuelle
Selon Robert Nideffer, il existe quatre styles attentionnels, croisant la direction (interne/externe) et l’étendue (étroite/large). Ils permettent à un individu de traiter efficacement les informations selon la situation:
- Interne-étroit: centré sur soi, un seul point (ex: respiration, sensation).
- Externe-large: analyse de l’environnement global (ex: placement stratégique).
- Interne-large: introspection, ressenti global (ex: fatigue, émotions).
- Externe-étroit: focalisation précise sur un élément extérieur (ex: balle, adversaire direct).
Ces styles s’activent selon le type d’effort attentionnel demandé (analyse, exécution, anticipation) et doivent être entraînés, comme une qualité physique.
II. La reconcentration: une mécanique en 3 temps
Les études en pleine conscience et en psychologie de la performance (Bernier et al., 2009) soulignent trois étapes clés:
- Prendre conscience de la distraction (pensée intrusive, émotion, stimulus).
- Accepter sans jugement. Éviter la lutte mentale, qui coûte cher en énergie.
- Rediriger volontairement son attention vers des éléments pertinents et préalablement définis.
Ce processus permet de maintenir l’engagement cognitif sous pression et évite le piège de la rumination mentale, souvent déclencheur de baisse de performance.
III. Routines attentionnelles: structurer pour automatiser
Les meilleurs athlètes, artistes et professionnels sous pression développent des routines attentionnelles: un enchaînement d’actions, de pensées ou d’images mentales qui déclenchent un état optimal de concentration.
Inspirés notamment par Marshall & Paterson (The Brave Athlete, 2017), ces protocoles mentaux permettent de:
- réduire le stress en situation incertaine,
- créer un repère stable malgré l’environnement,
- automatiser les premières secondes décisives d’une action.
L’enjeu ? Ne pas surcharger. Une routine mentale efficace est simple, personnalisée et limitée à quelques balises.
IV. Choking effect: le danger de trop penser
Phénomène bien connu en psychologie du sport, le “choking under pressure” survient lorsqu’un individu sur-analyse une tâche pourtant automatisée, généralement sous stress. Il peut alors régresser en performance.
Trop d’attention tue l’action.
Il est donc crucial d’éviter la surcharge attentionnelle, en particulier dans les disciplines techniques. Quelques focus bien choisis valent mieux qu’une check-list mentale interminable.
V. Entraîner l’attention, concrètement
L’attention ne se décrète pas, elle s’entraîne comme un muscle. Plusieurs stratégies sont validées:
- Exercices de flexibilité attentionnelle: alterner interne/externe, étroit/large.
- Simulation de perturbations (bruit, fatigue, pression).
- Exercices d’imagerie mentale (se visualiser en situation difficile).
- Travail en pleine conscience: scan corporel, respiration, observation des pensées.
- Intégration aux séances techniques: créer une surcharge cognitive contrôlée.
Il s’agit de construire une endurance attentionnelle, condition clé d’un engagement soutenu dans la durée.
VI. L’attention: un pouvoir mental à apprivoiser
L’attention est un levier décisif de performance, mais elle repose sur trois piliers:
- Une compréhension fine de ses propres styles attentionnels.
- Une planification d’entraînement mental aussi rigoureuse que celle du physique.
- Une capacité à revenir à l’essentiel, même dans le bruit.
Comme l’écrit Jean-Philippe Lachaux, spécialiste des neurosciences cognitives:
Apprivoiser son attention, c’est reprendre le pouvoir sur sa vie mentale
Avec l'application mobile de préparation mentale Mentaïa, il est possible de travailler chaque jour sa concentration.